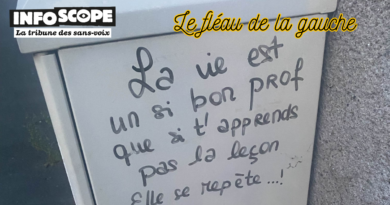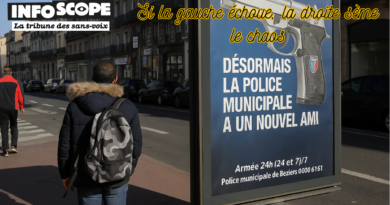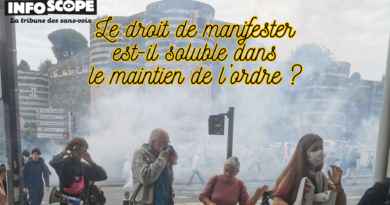La boîte à outils municipale de LFI : entre cohérence nationale et centralisme assumé ?
Fin mars, à un peu plus d’un an des prochaines élections municipales, la France Insoumise a dévoilé sa “boîte à outils programmatiques municipales 2026”.
Ce scrutin est le premier où LFI semble déterminée à s’investir dans la bataille locale.
Présenté par les député·es Clémence Guetté et Hadrien Clouet, chargé·es du programme du mouvement, l’outil à destination des militant·es insoumis·es sur le terrain s’annonce ambitieux. Mais qu’en est-il réellement ?
Un travail programmatique inédit
Comme à leur habitude, les cadres de LFI n’ont pas lésiné sur le travail programmatique. Lors d’une assemblée participative en décembre 2024, les militant·es avaient validé neuf grands principes comme base d’un programme municipal soutenu par le mouvement.
La stratégie jusqu’au boutiste –le programme rien que le programme- de la France Insoumise exclut de fait les autres partis. En ce sens, le premier point : “commencer la révolution citoyenne dans les communes” démontre que le mouvement des insoumis n’est pas prêt à s’allier avec les autres partis de gauche si facilement.
Les huit autres priorités énoncées :
- gérer les communs via des régies publiques,
- instaurer une règle verte à l’échelle communale,
- créer des communes “zéro chômeur” pour garantir le droit à l’emploi,
- lutter contre la spéculation immobilière,
- proposer une alimentation 100 % bio, locale et gratuite dans les cantines,
- défendre l’école publique et laïque,
- faire des communes des espaces antiracistes, féministes et inclusifs,
- s’engager pour la paix.
Ces propositions relèvent d’un socle commun que toute municipalité de gauche pourrait partager.
Une structure pensée dans les moindres détails
Le programme est décliné en quatre grandes parties : commencer la révolution citoyenne (axe central de la doctrine insoumise), planifier l’écologie, fortifier l’entraide, et construire la nouvelle France. Chaque partie est structurée autour de : propositions contextualisées ou données chiffrées, actions concrètes dites « précisions méthodologiques », estimation des coûts (de 1 à 3), échelle d’application (petites ou grandes communes), exemples tirés de l’action d’élu·es insoumis·es.
Autrement dit, LFI a fait ses devoirs. Aucun autre parti, à gauche comme à droite, ne peut revendiquer un tel travail de fond à ce jour.
En complément de ce kit, des assemblées municipales ont été créées pour choisir les stratégies locales et désigner des chef·fes de file. Le tout est ensuite validé par un comité électoral chargé d’en vérifier la cohérence avec la ligne nationale.
Un virage local assumé
La France Insoumise, mouvement plutôt axé vers les élections nationales jusqu’ici, amorce un tournant. Ce désintérêt relatif pour l’échelon municipal s’explique peut-être par un facteur simple : les élections législatives déterminent le financement public des partis, calculé sur les résultats du premier tour et le nombre de parlementaires élus.
Les municipales de 2026 seront donc un test décisif : LFI parviendra-t-elle à s’imposer comme force de gauche incontournable à l’échelle locale ? Avec quelles alliances ? Et dans quelles conditions ?
On se souvient, par exemple, de l’épisode tendu de Villeneuve-Saint-Georges, où Louis Boyard, pourtant donné favori, a finalement été désavoué par ses propres allié·es.
La survie du Parti Socialiste, après la présidence Hollande (2012-2017), s’explique peut-être par son ancrage territorial fort, entretenu par ses baronnies locales qui lui assurent encore des sièges de sénateur·ices. D’où l’importance de miser sur l’ensemble des élections.
Un outil redoutable, mais à double tranchant
Si utilisé, cet outil pourrait s’avérer redoutablement efficace.
Premièrement, il permet de garantir une cohérence nationale : chaque militant·e peut défendre un programme homogène, quelle que soit sa commune.
Deuxièmement, il offre un cadre de formation politique, à l’image du travail de la Fondation La Boétie, et soulage les militant·es en période électorale pour qu’ils se concentrent sur le terrain ou les spécificités locales.
Troisièmement, il repolitise l’échelon municipal, Puisque contrairement à ce qu’Alain Juppé formulait « Un tramway, ce n’est ni de droite ni de gauche » chaque politique publique a une couleur politique. Choisir un tramway c’est choisir : un trajet, une fréquence et un prix d’utilisation et tous ces éléments ont une couleur politique.
Cependant, si le lecteur du kit est prévenu que la boîte à outils n’a pas vocation à remplacer un programme local, on peut se questionner sur un trop grand lissage et à terme la perte de richesses des différences territoriales.
Donner clef en main un programme politique permet de nourrir ses militant-e-s mais donne aussi la possibilité de créer de nouveaux militant-e-s playmobil et d’annihiler complètement les propositions des habitant-e-s des territoires. Si il écrit noir sur blanc le choix de LFI “être en symbiose avec la volonté dégagiste des milieux populaires” et de “rendre le pays à ceux qui le font vivre”. Quelle place un kit municipal laisse pour les initiatives locales ?
Soit LFI fait entièrement confiance à ses militant-e-s soit la stratégie passe par un centralisme démocratique aidé de petits soldats possédant des kits déclinables à chaque échelon.
Le PS comme repoussoir, la démocratie comme négation
La crainte de reproduire le PS et ses logiques de notabilisation hante LFI.
Dans l’introduction du kit, cette peur est clairement formulée :
“Aucun insoumis n’a pour objectif de se transformer en notable, ni de créer une caste de bureaucrates territoriaux qui croient tout savoir mieux que les administrés.”
Mais cette obsession finit par nourrir une forme de paranoïa, empêchant LFI de construire une structure plus démocratique et pérenne.
La peur des baronnies tue la possibilité d’une vraie délibération locale.
Entre mouvement gazeux et centralisme démocratique
Il existe une contradiction entre la supposée souplesse créée par un mouvement qui se vante de ne pas être un parti et d’avoir une structure gazeuse (ou télégrammeuse).
Jean-Luc Mélenchon l’assume dans un entretien “L’insoumission est un nouvel humanisme” https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article42236#outil_sommaire_0
“Nous ne voulons pas être un parti. Le parti, c’est l’outil de classe. Le mouvement est la forme organisée du peuple. L’idée, c’est d’articuler le mouvement, sa forme et son expression : le réseau. Je sais que ce n’est pas évident à comprendre pour les seniors de la politique qui trimballent leurs vieux scénarios des années soixante, mais le but du mouvement de la France insoumise n’est pas d’être démocratique mais collectif. Ça n’a rien à voir avec la logique d’un parti. De plus, il doit être un organe utile. Alors les copains distribuent de la nourriture, vont chercher des vêtements, aident les gens à demander les prestations sociales auxquelles ils ont droit. Et pour le reste, le mouvement ne fait que des campagnes.”
Le projet de LFI repose donc sur deux piliers : agir avec les initiatives locales existantes (distributions alimentaires, entraide) et mener des campagnes électorales.
Sur le papier, pourquoi pas. En pratique, difficile de ne pas voir le trou dans la raquette. Quelle place cette stratégie laisse aux militant-e-s insoumis-e-s de créer des initiatives à l’extérieur et à l’intérieur du mouvement ? Comment savoir si LFI ne s’intéresse au mouvement social que pour mieux en tirer des voix ?
Pour exemple, les attaques régulières du mouvement envers les syndicats et en particulier la CGT trahissent une forme de désengagement vis-à-vis du mouvement syndical et donc un éloignement de « la volonté populaire ».
La stratégie des insoumis inclut à chaque pas “le peuple”, ceci étant toutes les contradictions apportées à LFI sont traitées comme des trahisons politiques.
Alors soit, LFI travaille efficacement à une rupture radicale avec le capitalisme contrairement aux autres partis de gauche, mais leur stratégie jusqu’au boutiste “la fin justifie les moyens” sera-t-elle suffisante ?
Votre soutien garantit notre indépendance
Infoscope est une association à but non lucratif, un média angevin engagé et indépendant qui participe à la bataille de l’information depuis 2019.
Nous levons actuellement des fonds pour la réalisation d’un nouveau documentaire, La Fin De Leur Monde, qui sera, comme nos quatre premiers, disponible en accès libre sur YouTube.
Participez à notre campagne de financement et soutenez une équipe jeune et intégralement bénévole !