Le RN est raciste, LFI est-elle antisémite ? Bilan contre bilan
Dans sa conférence de presse de près de deux heures tenue hier mercredi 12 juin, le Président Emmanuel Macron a renvoyé dos à dos « les deux extrêmes ».
La Tribune des Sans-Voix
La Gouline, c’est l’émission de débat et d’analyse d’Infoscope, diffusée en direct tous les lundis, sur Twitch. Un moment d’échange sans filtre où nous prenons le temps d’explorer des sujets d’actualité sous un angle critique et engagé. Un espace de réflexion et de discussion Avec La Gouline, nous refusons la dictature du buzz et de l’info en continu. Ici, on prend le temps de comprendre, d’analyser et de débattre en profondeur, loin des formats traditionnels. Chaque émission s’articule autour de discussions engagées, d’invités spécialisés et de rubriques thématiques, offrant un regard indépendant sur les sujets qui façonnent notre société. Un regard libre sur l’actualité Chaque semaine, nous vous proposons une émission où l’actualité n’est pas simplement commentée mais déconstruite. Loin des narrations dominantes imposées par les grands médias, La Gouline donne la parole à celles et ceux qui vivent directement les transformations sociales et politiques. Un engagement dans la continuité d’Infoscope Dans la lignée de nos productions comme Nous Sommes En Guerre, Un Pognon de Dingue, ou plus récemment La Fin de leur Monde, La Gouline s’inscrit dans notre démarche de journalisme indépendant. Nous explorons l’actualité à travers un prisme critique, en impliquant aussi bien nos invités que notre communauté. Rejoignez-nous en direct sur Twitch et retrouvez tous les replays sur YouTube ! La playlist de la saison: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBVL-Vlotxge-jNyfcqMR-Gt-xqZT3io4
Comment la performance de Léa Vinette et Nicolas Houel interroge sur l’accessibilité de l’Art pour tous et toutes à partir d’un tarif plein de 12 euros Au Parc Balzac d’Angers, dans le cadre du programme « Vers les étoiles » du [CNDC], la performance de Léa Vinette, suivie d’une rencontre avec Nicolas Houel, a offert une expérience artistique singulière, immersive et sensorielle, invitant le public à explorer la nuit, l’introspection et la perception.Le CNDC, ou Centre National de Danse Contemporaine, est une institution de référence en France dédiée à la création, à la formation et à la diffusion de la danse contemporaine. Sa mission est de soutenir les artistes chorégraphiques, d’accompagner la recherche et l’innovation dans le domaine de la danse, mais aussi de sensibiliser tous les publics à cet art par des actions pédagogiques, des spectacles et des rencontres. Véritable laboratoire artistique, le CNDC favorise l’accès à la danse pour le plus grand nombre, tout en contribuant au rayonnement culturel d’Angers et de la région. Mais au-delà de la proposition artistique, l’événement soulève une question centrale : à qui s’adresse l’Art, quand le tarif d’accès s’établit à 12 euros pour une soirée en plein air ? Avant d’aller plus loin, nous tenons à remercier chaleureusement le CNDC d’Angers de nous avoir contactés, nous, Infoscope Productions, pour écrire un article sur cette performance et de nous avoir invités gracieusement à y assister. Cette attention témoigne de leur volonté d’ouvrir leurs événements à des regards extérieurs et de favoriser la diffusion de la création chorégraphique contemporaine.Et nous, à Infoscope Productions, cela nous permet d’étoffer notre « rubrique » Culture — c’est à dire quelques anecdotiques et médiocres articles d’Adam Fourage — et de partager avec notre public des expériences artistiques uniques et inspirantes. Une expérience qui se veut universelle… mais pour qui ? La démarche artistique de Léa Vinette, qui mise sur la proximité, la sensorialité et l’intimité du noir, appelle à une ouverture, à une démocratisation de l’expérience artistique. « Plus nous entrons dans la nuit, plus la jeune femme disparaît, plus le·la spectateur·ice est invité·e à affiner ses sens, à se rapprocher d’elle par la vibration de son corps, le son de son souffle puis de sa voix », décrit la présentation du spectacle[Vers les étoiles]. Nox est un solo où la danse devient un voyage sensoriel du blanc éclatant (ouate de cellulose[image]) vers l’obscurité profonde.Nox est une performance d’une renaissance et une renaissance d’un être vivant. Au cœur de la pièce, une jeune femme vit seule dans un espace froid, immaculé, où la lumière semble abolir toute nuance. Progressivement, l’obscurité s’installe, bouleversant l’équilibre du lieu et de la protagoniste, qui traverse alors une série d’états physiques et émotionnels contradictoires : anxiété, curiosité, perte de repères, mais aussi émerveillement et puissance. La lumière,élément central du dispositif, évolue de façon minimaliste, orchestrant une lente plongée vers le noir. Ce basculement progressif n’est pas qu’une disparition : il devient une invitation à explorer la multiplicité de soi, à se confronter à la peur du vide, mais aussi au plaisir de l’introspection et à la force d’un corps « primitif », chargé d’une « violence gracieuse »[Cult.news][Léa Vinette]. Inspirée par la pollution lumineuse et la disparition du ciel étoilé, Léa Vinette interroge notre rapport à la nuit, à la transformation, à la dissolution des frontières de l’identité. La performance oscille entre émerveillement et inquiétude, plaisir et douleur, cosmos et intimité, tout en déconstruisant les images traditionnelles du corps féminin. Ce voyage, qui vise à toucher chacun et chacune dans son rapport à soi et au monde, se heurte pourtant à la réalité économique de l’accès. Un prix, une barrière ? [CNDC]Le tarif plein de 12 euros, s’il reste inférieur à certains standards du spectacle vivant, n’est pas anodin pour tous les publics. Dans un contexte où l’inflation pèse sur les budgets et où la culture est parfois reléguée au rang de dépense optionnelle, ce prix interroge : qui peut réellement accéder à une performance comme celle de Léa Vinette et Nicolas Houel ? Pour une famille, un groupe d’amis, ou des personnes aux revenus modestes, la somme peut vite devenir un frein, même pour un événement en extérieur. Mais pourquoi ? Nous allons établir trois hypothèses. I – 12€, c’est le prix qui rémunère les artistes Pour le néophyte, l’expérience de Léa Vinette est assez spectaculaire. Bouger au rythme d’une musique minimaliste, pendant la moitié d’une heure, relève de l’exploit. L’artiste, qui a eu une carrière contrariée, à cause d’une blessure, montre la grande maîtrise de ses gestes. Il en va de même avec Nicolas Houel. Au travers son expérience sensorielle, l’idée de rapprocher ses émotions du concept de la nuit, cela interroge, cela intrigue. Tout ça, c’est du travail, au sens économique le plus littéral. MM. Vinette, Houel, ainsi que toutes les personnes au sein du CNDC, ne font pas tout ça pour des peccadilles. Après tout, il a fallu préparer la chorégraphie, organiser l’événement, trouver le bon endroit, inviter la presse, même s’il s’agit de nous… II – 12€, c’est une forme de privatisation de l’Art Le problème, quand on est néophyte, il faut admettre qu’il est difficile de s’imprégner totalement d’un spectacle de danse contemporaine. Assez trivialement, il faut de la musique pour danser. Quand il n’y en a pas, ou quasiment pas, comprenons qu’il faille faire une gymnastique intellectuelle. On le remarque bien avec ce spectacle. La danse — voire même l’art — contemporain jouit d’une image d’art réservé aux élites. Ici, cela se constate un petit peu: la plupart des spectateurs ont déjà vu au moins une fois un spectacle de danse contemporaine. 12€, cela semble peu cher, c’est à peu près autant qu’une séance dans un cinéma Pathé. Pour autant, on ne va pas dire qu’un spectacle de danse contemporaine est aussi accessible qu’un film d’auteur. Alors qu’il en existe des films d’auteur abscons ! III – 12€, un constat d’échec Le CNDC est bien conscient que pour apprécier cette forme d’art, la pédagogie est nécessaire. Rappelons qu’il est une association, pas une entreprise. Ce qu’on paie, c’est aussi la pérennité du seul Lire la suite
Dans cet article, nous allons posément parler de La Meute. A moins de vivre, soit en autarcie, soit en Corée du Nord, tout le monde sait de quoi il s’agit. Pour nos camarades nord-coréens : c’est un véritable best-seller ! Cet ouvrage est une enquête autour de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise (LFI), de 300 et quelques pages, rédigé par les journalistes Charlotte Belaïch et Olivier Pérou, respectivement à Libération et au Monde, publié en mai 2025 aux éditions Flammarion. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il ne laisse personne indifférent. Même au sein de notre rédaction, nous en avons déjà consacré un sujet David Dufresne – rédacteur en chef du média indépendant Au Poste ! – quant à lui, a carrément réussi à avoir un entretien avec les deux nouvelles starlettes du journalisme d’investigation. Bien que le dispositif était prévu pour durer deux heures, le réalisateur d’Un pays qui se tient sage n’en a obtenu qu’une 1h10. On ne saura pas pourquoi la chargée de production, présente, a prévenu au dernier moment la rédaction. Cependant, c’est assez suffisant pour comprendre tout ce qui ne va pas. A celles et ceux qui critiquent le livre, même sans l’avoir lu, vous avez raison. Grâce à l’entretien de David Dufresne (que nous invitons à regarder dans son intégralité), voici pourquoi. Portrait-robot des néo-nouveaux chiens de garde Commençons par présenter les deux protagonistes : on remarque tout de suite que Charlotte Belaïch est plus habituée à poser des questions qu’à y répondre. Elle a visiblement souffert face à la contradiction d’un chat, comme le prévoit pourtant l’émission, puisqu’elle est diffusée sur des plateformes de direct comme Twitch. Un commentaire sur le replay disponible sur YouTube écrit d’ailleurs très justement: “J’ai bien écouté cette émission. Au début, c’est en particulier flagrant chez Charlotte [Belaïch, NDR], elle a un ton tout mignon, genre, vous voyez, on a bien fait notre travail, on est les gentils. Mais vers la fin de l’entretien, dès qu’elle se sent attaquée, son ton s’éloigne beaucoup du ton apaisé du début. Elle devient agressive. Exactement ce qu’elle reproche à LFI |…|”. Assez personnellement, il semble qu’Olivier Pérou soit, quant à lui, assez sincèrement à gauche. Il affirme haut et fort ne pas vouloir défendre son travail dans un média comme CNews, bien conscient, a priori, que ce dernier roule pour l’extrême-droite. Ce qui ne veut pas dire qu’il est de gauche. Affirmer, comme il le fait, chez Au Poste !, que Mélenchon: “on n’en fera plus des comme lui” (à 1h20 dans l’entretien) ne veut pas dire qu’on a bien intégré les principes programmatiques de La France Insoumise. Sa carrière est très linéaire : avant d’être au Monde, il a travaillé à l’Express. Quand on travaille dans le milieu, cela ressemble à une ascension un peu trop belle, pour quelqu’un qui part avec des avantages évidents dans la vie. Sa posture le trahit. Il passe l’entretien, très bien vissé dans le canapé, jambes croisées, en contrôle. En fait, ce qui fait qu’il est À et non DE gauche, c’est son discours, emprunt de moralisme, ce qui est assez banal chez quelqu’un qui ressemble, tout de même, à un sacré bobo ! L’investigation des petites phrases Pour défendre sa bonne foi, Charlotte Belaïch explique que son boulot, c’est journaliste, pas politique. Pour une journaliste politique, avouons que c’est cocasse… Mais, parlons un petit peu de la méthode de l’enquête. Sur ce point, le bouquin fait la part belle aux “off”. Ce terme fait partie du jargon technique du journalisme. Le journaliste récupère à la volée les déclarations des politiques dans les moments où leur défense est baissée car ils s’adressent dans un cadre privé. La personne en question, bien souvent anonymisée, puisque la discussion est informelle, y donnerait un point de vue plus pertinent puisque, c’est bien connu, ce n’est que quand les micros sont éteints que les politiciens sont sincères. Charlotte Belaïch et Olivier Pérou en parlent presque joyeusement, que ce soit dans le livre, en prenant exemple d’un bistrot dans le 10e arrondissement, L’Escalier, qui aurait été le QG de la France Insoumise aux alentours de 2017 ou tantôt dans un troquer du 7e arrondissement, près de l’Assemblée Nationale. Quand on est loin de tout ce tintouin, on est en droit de trouver la démarche très caricaturale. Cela interroge carrément la pertinence de la démarche. L’informel, la petite phrase, les intrigues de couloir, sont ils réellement des manières de mener une enquête ? Pour David Dufresne, la réponse est non. Il admet, lors du debriefing diffusé directement après l’interview, avoir brisé le secret qu’insinue le off, lorsqu’il traitait l’affaire de Tarnac. Olivier Pérou, qui semble très attaché à cette pratique, explique qu’elle a servi de base pour “se muer en journalistes d’investigation”. Malheureusement pour lui, jouer au journaliste d’investigation ne fait pas de soi un bon enquêteur. En tout cas, on comprend pourquoi Le Monde ne l’a pas affecté à ce service mais plutôt dans la rubrique politique, il n’en a franchement pas les compétences. Le pire, c’est que M. Pérou fait une publicité désastreuse de son travail, qui se nourrit de ces off. Le problème, c’est qu’en plus de jeter l’opprobre, voire le discrédit, cela est réducteur pour la vie politique, faisant fi des débats internes dans les partis. On amalgame la position d’une figure à celle de son organisation, oubliant qu’il s’agit de collectifs et donc, fatalement, de pluralités d’opinions. Entre-soi sectaire La thèse du livre reprend la thèse de l’aspect sectaire attribué à la France Insoumise. L’idée, c’est que la violence, faisant système, sert un mouvement qui se fond dans les projets personnels du chef. David Dufresne, encore lui, déconstruit très bien cette notion, avec les auteurs. Une secte, ça fait peur. Si la France Insoumise en est une, alors le lecteur doit légitimement avoir peur de cette organisation.On remarque l’expérience et la malice du journaliste, qui est passé, lui aussi, au sein de la rédaction de Libération. Lui aussi, fut à la place Lire la suite
L’élection de Bruno Retailleau à la tête du parti Les Républicains (LR), le 18 mai dernier1, propulse la droite dans une nouvelle dynamique. Celle-ci laisse craindre aux citoyens et autres administrés une réaction violente à tous les mouvements d’émancipation portés, çà et là, par les classes populaires. Dans cette optique, les scrutins municipaux du printemps 2026 revêtent un enjeu renforcé. Quiconque voit plus loin que le bout de son nez sait qu’il s’y joue moins la gouvernance de l’échelon territorial le plus proche des habitants que la recomposition profonde du paysage politique français2. Une réunification radicale Nul ne peut ignorer qu’en 2027 s’achèvera le décennat d’Emmanuel Macron à l’Élysée. La porte-parole du gouvernement lui-même, composé des premiers fidèles au chef de l’État et de figures de la droite traditionnelle, prédit la fin du macronisme dans les mois à venir3. Que Sophie Primas professe cette intime conviction sur le plateau de CNews, chaîne dite d’information appartenant à la galaxie Bolloré, n’est pas un hasard. Mme Primas est une alliée de Bruno Retailleau4 , actuel ministre de l’Intérieur et nouvel homme fort de la droite. Ce camp politique, éparpillé façon puzzle au lendemain des élections législatives anticipées et de la victoire relative de la coalition de gauche du Nouveau Front Populaire (NFP), s’est réunifié à la faveur de l’ultime virage à droite du Président de la République, celui-là même qui l’a amené à nommer place Beauvau M. Retailleau, poulain vendéen de l’ultra-réactionnaire Philippe de Villiers voici encore quinze ans5. Autant dire que M. Macron a décidé de confier les rênes du pays à l’extrême-droite. Ce que ses réels patrons, la classe capitaliste des milliardaires français, lui avaient intimé de provoquer par la dissolution, à savoir la mise en place d’un gouvernement nationaliste en cas de victoire du Rassemblement National (RN) au scrutin du 7 juillet, scénario défait par la puissante mobilisation citoyenne, le chef de l’État l’aura réalisé par une alliance absurde d’un point de vue démocratique avec les forces réactionnaires des LR, pourtant en bien mauvaise posture lors des législatives quand leur propre patron, Eric Ciotti, avait rallié Marine Le Pen et Jordan Bardella6. Parce que c’est leur projet Sous le gouvernement Barnier et plus encore sous celui du Premier ministre François Bayrou, Bruno Retailleau fait la pluie et le beau temps7. En l’espace de quelques mois, il aura conduit la politique la plus ouvertement xénophobe par la criminalisation des réfugiés8, précipité la France dans un conflit diplomatique ouvert avec l’Algérie, fait de l’islam l’ennemi numéro un à abattre sous couvert de combattre tour à tour « l’islamisme », « l’islam radical », « l’islam politique » ou le « frérisme”9 , et enfin planté les germes d’une déchirure terrible dans la communauté nationale, seule reconnue par la République et dont les pans sont dressés les uns contre les autres sur des considérations essentialistes10. Tout cela, M. Retailleau l’a fait avec l’assentiment, si ce n’est le soutien franc, des députés RN. Le projet de la nomination de M. Bardella à Matignon, fomenté par la classe dirigeante, a été déjoué par le suffrage universel aux élections législatives connaissant le plus fort taux de participation depuis 199711, voyant la victoire du front républicain ? Alors la classe dirigeante s’est employée à faire exploser le front républicain, bien aidée par un NFP qui a commis, tant par son intransigeance programmatique dans une configuration défavorable que par son renoncement à prendre la mesure du coup d’Etat tranquille et de l’illégitimité des gouvernements en place depuis le 8 juillet, la faute d’avoir abandonné l’idée de gouverner. Le rêve caressé par Vincent Bolloré, mécène avec Pierre-Edouard Stérin de l’union des droites12, comprendre des héritiers de De Gaulle aux enfants de Pétain, pour lequel avait été missionné Eric Zemmour dans la dernière élection présidentielle, se produit désormais au sommet de l’Etat sous l’égide de M. Retailleau. Saisir cette dynamique est essentiel pour appréhender sérieusement les prochaines élections municipales. Tactique locale et stratégie nationale Un animal politique éprouvé verrait en un coup d’oeil que les scrutins communaux de 2026 sont au moins un marche-pied pour l’élection présidentielle de 2027 et plus globalement une marche décisive dans la restructuration politique. Si notre rédaction a été, par deux fois ces deux dernières semaines, sévèrement critique à l’égard de la gauche dans son approche des municipales, c’est bien parce que le camp du progrès humain ne semble pas prendre la mesure de ce qui se joue dans les prochains mois. A Angers, ville de Christophe Béchu, numéro deux du parti Horizons d’Edouard Philippe, lequel ne cache pas sa « bromance » avec Bruno Retailleau13, les formations de gauche dessinent à ce jour un scénario sensiblement identique à celui des précédentes élections de 2020. Il y a cinq ans, trois listes de gauche se livraient concurrence pour mieux faire réélire dès le premier tour le chantre de la droite traditionnelle, catholique et néolibérale de l’Ouest. Combien de projets à gauche (et pas d’extrême-gauche, Lutte Ouvrière mise à part) se préparent parallèlement et activement à composer une liste, préparer un programme, imprimer tracts et affiches, les distribuer et coller, affirmer leurs divergences pour quelques ambitions égocentriques ou quelques grands électeurs aux scrutins sénatoriaux ? Trois. Bien entendu, cela ne serait qu’un épiphénomène si ce n’était pas décliné, de façon variable mais similaire, dans toutes les grandes villes de France. L’incapacité à gouverner du NFP, coalition rassemblant toute la gauche de rupture avec le néolibéralisme macroniste et de combat contre le nationalisme lepéniste, a peu à peu détourné toutes ses composantes de cette stratégie pourtant gagnante. Orphelines d’une stratégie unitaire à même de garantir la première place aux scrutins nationaux, sinon le premier rempart au fascisme rampant, les formations de gauche sont retombées dans leurs couloirs spécifiques à chacune, espaces qui présentent l’avantage d’être confortables et l’inconvénient de garantir la défaite. Face à elles, la droite se présente en rangs serrés idéologiquement, le pseudo-vernis social du RN ne résistant pas aux sirènes du pouvoir politique sous le capitalisme14, le pseudo-progressisme sociétal du « centre-droit » volant en éclats sous la déferlante idéologique réactionnaire15. L’exercice du Lire la suite
Fin mars, à un peu plus d’un an des prochaines élections municipales, la France Insoumise a dévoilé sa “boîte à outils programmatiques municipales 2026”.Ce scrutin est le premier où LFI semble déterminée à s’investir dans la bataille locale. Présenté par les député·es Clémence Guetté et Hadrien Clouet, chargé·es du programme du mouvement, l’outil à destination des militant·es insoumis·es sur le terrain s’annonce ambitieux. Mais qu’en est-il réellement ? Un travail programmatique inédit Comme à leur habitude, les cadres de LFI n’ont pas lésiné sur le travail programmatique. Lors d’une assemblée participative en décembre 2024, les militant·es avaient validé neuf grands principes comme base d’un programme municipal soutenu par le mouvement. La stratégie jusqu’au boutiste -le programme rien que le programme- de la France Insoumise exclut de fait les autres partis. En ce sens, le premier point : “commencer la révolution citoyenne dans les communes” démontre que le mouvement des insoumis n’est pas prêt à s’allier avec les autres partis de gauche si facilement. Les huit autres priorités énoncées : gérer les communs via des régies publiques, instaurer une règle verte à l’échelle communale, créer des communes “zéro chômeur” pour garantir le droit à l’emploi, lutter contre la spéculation immobilière, proposer une alimentation 100 % bio, locale et gratuite dans les cantines, défendre l’école publique et laïque, faire des communes des espaces antiracistes, féministes et inclusifs, s’engager pour la paix. Ces propositions relèvent d’un socle commun que toute municipalité de gauche pourrait partager. Une structure pensée dans les moindres détails Le programme est décliné en quatre grandes parties : commencer la révolution citoyenne (axe central de la doctrine insoumise), planifier l’écologie, fortifier l’entraide, et construire la nouvelle France. Chaque partie est structurée autour de : propositions contextualisées ou données chiffrées, actions concrètes dites « précisions méthodologiques », estimation des coûts (de 1 à 3), échelle d’application (petites ou grandes communes), exemples tirés de l’action d’élu·es insoumis·es. Autrement dit, LFI a fait ses devoirs. Aucun autre parti, à gauche comme à droite, ne peut revendiquer un tel travail de fond à ce jour. En complément de ce kit, des assemblées municipales ont été créées pour choisir les stratégies locales et désigner des chef·fes de file. Le tout est ensuite validé par un comité électoral chargé d’en vérifier la cohérence avec la ligne nationale. Un virage local assumé La France Insoumise, mouvement plutôt axé vers les élections nationales jusqu’ici, amorce un tournant. Ce désintérêt relatif pour l’échelon municipal s’explique peut-être par un facteur simple : les élections législatives déterminent le financement public des partis, calculé sur les résultats du premier tour et le nombre de parlementaires élus. Les municipales de 2026 seront donc un test décisif : LFI parviendra-t-elle à s’imposer comme force de gauche incontournable à l’échelle locale ? Avec quelles alliances ? Et dans quelles conditions ?On se souvient, par exemple, de l’épisode tendu de Villeneuve-Saint-Georges, où Louis Boyard, pourtant donné favori, a finalement été désavoué par ses propres allié·es. La survie du Parti Socialiste, après la présidence Hollande (2012-2017), s’explique peut-être par son ancrage territorial fort, entretenu par ses baronnies locales qui lui assurent encore des sièges de sénateur·ices. D’où l’importance de miser sur l’ensemble des élections. Un outil redoutable, mais à double tranchant Si utilisé, cet outil pourrait s’avérer redoutablement efficace. Premièrement, il permet de garantir une cohérence nationale : chaque militant·e peut défendre un programme homogène, quelle que soit sa commune. Deuxièmement, il offre un cadre de formation politique, à l’image du travail de la Fondation La Boétie, et soulage les militant·es en période électorale pour qu’ils se concentrent sur le terrain ou les spécificités locales. Troisièmement, il repolitise l’échelon municipal, Puisque contrairement à ce qu’Alain Juppé formulait « Un tramway, ce n’est ni de droite ni de gauche » chaque politique publique a une couleur politique. Choisir un tramway c’est choisir : un trajet, une fréquence et un prix d’utilisation et tous ces éléments ont une couleur politique.Cependant, si le lecteur du kit est prévenu que la boîte à outils n’a pas vocation à remplacer un programme local, on peut se questionner sur un trop grand lissage et à terme la perte de richesses des différences territoriales. Donner clef en main un programme politique permet de nourrir ses militant-e-s mais donne aussi la possibilité de créer de nouveaux militant-e-s playmobil et d’annihiler complètement les propositions des habitant-e-s des territoires. Si il écrit noir sur blanc le choix de LFI “être en symbiose avec la volonté dégagiste des milieux populaires” et de “rendre le pays à ceux qui le font vivre”. Quelle place un kit municipal laisse pour les initiatives locales ? Soit LFI fait entièrement confiance à ses militant-e-s soit la stratégie passe par un centralisme démocratique aidé de petits soldats possédant des kits déclinables à chaque échelon. Le PS comme repoussoir, la démocratie comme négation La crainte de reproduire le PS et ses logiques de notabilisation hante LFI.Dans l’introduction du kit, cette peur est clairement formulée : “Aucun insoumis n’a pour objectif de se transformer en notable, ni de créer une caste de bureaucrates territoriaux qui croient tout savoir mieux que les administrés.” Mais cette obsession finit par nourrir une forme de paranoïa, empêchant LFI de construire une structure plus démocratique et pérenne.La peur des baronnies tue la possibilité d’une vraie délibération locale. Entre mouvement gazeux et centralisme démocratique Il existe une contradiction entre la supposée souplesse créée par un mouvement qui se vante de ne pas être un parti et d’avoir une structure gazeuse (ou télégrammeuse). Jean-Luc Mélenchon l’assume dans un entretien “L’insoumission est un nouvel humanisme” https://www.europe-solidaire.org/spip.php?article42236#outil_sommaire_0 “Nous ne voulons pas être un parti. Le parti, c’est l’outil de classe. Le mouvement est la forme organisée du peuple. L’idée, c’est d’articuler le mouvement, sa forme et son expression : le réseau. Je sais que ce n’est pas évident à comprendre pour les seniors de la politique qui trimballent leurs vieux scénarios des années soixante, mais le but du mouvement de la France insoumise n’est pas d’être démocratique mais collectif. Ça n’a rien à Lire la suite

Dans sa conférence de presse de près de deux heures tenue hier mercredi 12 juin, le Président Emmanuel Macron a renvoyé dos à dos « les deux extrêmes ».
![[Podcast] Europe en guerre : le courage de la paix, avec Annick Martin, Daniel Renou et Jean-Claude Lecoq [Podcast] Europe en guerre : le courage de la paix, avec Annick Martin, Daniel Renou et Jean-Claude Lecoq](https://infoscope.live/wp-content/uploads/2024/03/BanniereWPemissionMars-390x205.png)
On se l’était promis: plus jamais ça. La guerre. En Europe. Mais depuis 2022, la donne a changé, la Russie
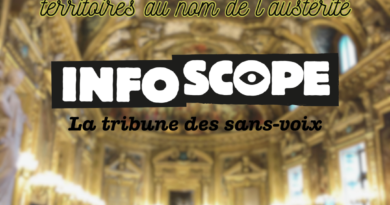
Lundi 18 novembre, le 106e congrès des maires de France s’est tenu dans un contexte de tension palpable. Au Palais du Luxembourg, les petits fours offerts par des sénateur-ice-s soucieux de leur réélection en 2026 n’auront sans doute pas suffi à faire oublier les coupes budgétaires absurdes exigées par la minorité présidentielle. En toile de fond : un bras de fer budgétaire qui exacerbe la défiance entre l’État et les élu-e-s locaux.
![[Podcast] Une seule bannière : le Front Populaire, avec des responsables de LFI, d’EELV, du PS, du PCF et du NPA [Podcast] Une seule bannière : le Front Populaire, avec des responsables de LFI, d’EELV, du PS, du PCF et du NPA](https://infoscope.live/wp-content/uploads/2024/06/BanniereWPemissionJuin-390x205.png)
L’annonce a fait l’effet d’une bombe. A la suite des résultats de l’élection européenne, plaçant l’extrême droite en tête, le président de la République Emmanuel Macron a dissout l’Assemblée Nationale.