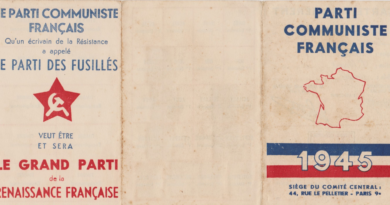Le Capital communiste 1/10 – Qu’est-ce que le capital ?
Le Capital communiste est une brochure écrite en juin 2023 par Benoit Delrue, journaliste et directeur de publication d’Infoscope.
Un an plus tard, à l’heure où le pays plonge dans la mécanique nationaliste, nous interrogeons les faillites de la gauche de transformation sociale, politique et révolutionnaire. Ce présent ouvrage, publié sur notre site en une série d’articles, y contribue.
Cette première des dix parties du document, que nous publions en exclusivité et en accès libre, en intégralité du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2024, comporte la Préface, l’Introduction : La Philosophie Communiste et le Chapitre 1 : Qu’est-ce que le Capital ?
Retrouvez la table des matières
*
**
Préface
*
Comment en être arrivé à la considération d’un capital communiste et à l’intérêt d’y consacrer une brochure ? De l’observation empirique jusqu’à la théorie d’un phénomène objectif qui agit assurément comme un frein à l’appropriation, par les masses laborieuses, de l’engagement authentiquement révolutionnaire, je me dois d’exposer mon cheminement.
A l’heure où j’écris ces lignes, j’en suis à ma quinzième année de « carte » au PCF. Adhérent au Mouvement des Jeunes Communistes de France (MJCF) et au Parti Communiste Français (PCF) depuis 2008, rien ne me prédisposait a priori à consacrer une part conséquente de mon existence au combat pour l’émancipation des classes exploitées, auquel je pense demeurer loyal jusqu’à la fin de mes jours.
Je ne suis pas issu d’une famille communiste, ni d’une ville communiste. A peine quelques mois avant d’adhérer aux organisations qui se réclament de cette doctrine au point de l’arborer fièrement dans leurs noms, je croyais le communisme mort, comme l’écrasante majorité de mon entourage. A vrai dire, on n’en parlait pas – mis à part les cours d’histoire de terminale, dont j’étais friand malgré une assiduité discutable, où furent évoqués en un seul chapitre « les totalitarismes du XXème siècle » que seraient le fascisme, le nazisme et le communisme.
J’étais néanmoins ce qu’on peut appeler un communiste qui s’ignore. Farouchement attaché aux principes d’égalité et de justice universelles, tout autant opposé aux idéologies libérales et réactionnaires qui avaient le vent en poupe dans les années 2000, j’ai grandi dans une famille de gauche mais qui n’avait jamais, parmi tous ses membres rencontrés dans mon enfance et mon adolescence, a fortiori parmi celles et ceux qui m’entouraient au quotidien, adhéré à une organisation syndicale ou politique. Mes parents, athées et pacifistes, nourrissaient particulièrement la critique des religions et l’antimilitarisme auxquels je resterais fidèle. Ils appartenaient à cette nouvelle classe ouvrière, celle qui travaillait dans les bureaux, qui oscillait d’une élection à l’autre entre les candidats socialistes, écologistes et trotskistes, et qui transmettait des valeurs à travers la culture populaire. J’ai grandi avec Les Guignols de l’Info, Jacques Brel, Georges Brassens et Steven Spielberg.
De nature curieuse et dévoué à des valeurs chevillées au corps, j’ai rapidement été attiré par la pratique de la rédaction puis, plus tard, par les manifestations populaires. Enfant, j’écrivais sur papier ou ordinateur au sujet de mes passions, au premier rang desquelles les animaux domestiques et les jeux vidéo. Lycéen, j’ai participé aux mobilisations, occupations, blocages, manifestations contre la réforme de François Fillon prévoyant la mise en place du contrôle continu pour l’examen du baccalauréat au printemps 2005, puis contre la mise en place du Contrat première embauche (CPE) porté par le Premier ministre Dominique de Villepin, un an plus tard. Entre ces deux victoires sociales qui ont permis d’empêcher de telles mesures de s’appliquer, je me suis passionné pour ce qui fut une victoire politique : le débat et le référendum sur le Traité constitutionnel européen, que j’avais lu puisqu’il avait été envoyé dans sa version intégrale à l’ensemble des électeurs de France, et je fus convaincu par le refus de cette vision ultralibérale de l’Europe grâce à la belle campagne, que je suivais à travers les médias, des représentants de la gauche unie pour le « Non ». Lequel l’emportait au soir du 29 mai 2005, déjouant les pronostics et la propagande dominante.
Tenté par l’anarchisme à travers des recherches faites sur Internet, j’entrepris un temps d’écrire ce que j’avais déduit de mes expériences de vie, c’est-à-dire que tout ce que nous avons en tête, notre vision du monde, la façon dont nous nous comportons et nos réactions les plus élémentaires, étaient le fruit de ce que nos cinq sens nous permettaient de ressentir du monde réel. Sans le savoir ni le formuler ainsi, j’ai compris que l’existence déterminait la conscience.
A la rentrée 2007, néo-bachelier et inscrit en licence de Lettres Modernes à l’Université de Lille-III, je suis devenu un militant. Non pas dans une organisation partisane, mais au sein du syndicat étudiant qui rayonnait encore par sa victoire récente contre le CPE : l’Union nationale des étudiants de France, l’UNEF. Là encore, sans le savoir, j’intégrais une équipe de militants essentiellement communistes, qui m’ont appris à organiser une grève et un blocage, contre la loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU) de la ministre Valérie Pécresse, tout autant que d’accompagner et défendre des étudiants confrontés à une situation difficile, qu’elle concerne l’inscription universitaire, l’expiration d’un titre de séjour ou un litige lié aux examens.
Mes camarades du syndicat se faisaient insistants pour que j’adhère au mouvement communiste, ce qui semblait pour le passionné d’histoire que j’étais une chose pratiquement inconcevable, malgré la sympathie que j’avais pour eux. Trois événements sont survenus me faisant passer le pas de l’adhésion au MJCF, outre mon engagement quotidien au sein d’une section lilloise de l’UNEF largement maîtrisée par des militants communistes.
Le premier est l’expérience du travail salarié, à l’été 2008 et au début de ma deuxième année universitaire, au sein d’un établissement de restauration rapide, Quick. Je vivais ce qu’était la pression, la hiérarchie, l’exploitation, l’écart gigantesque entre le chiffre d’affaires que les autres équipiers polyvalents et moi-même générions chaque heure et nos salaires plafonnés au SMIC à temps partiel.
Le deuxième est le krach boursier mondial consécutif à la faillite de la banque étasunienne Lehman Brothers, qui engendra pour unique réaction de l’État-nation présidé par Nicolas Sarkozy la volonté politique de « sauver » coûte que coûte le système bancaire, à travers le déblocage de 360 milliards d’euros pour la France, qui les empruntera sur un marché financier… aux mêmes institutions capitalistes que l’on aidait, par l’impôt prélevé sur les travailleurs de notre pays, pendant que l’on exigeait des petites gens de se serrer la ceinture en cette période de « crise ».
Le troisième événement, dernier domino à tomber dans ma tête avant que je prenne ma carte, est ma participation à une réunion de syndicalistes étudiants communistes au sein de l’imposant Colonel Fabien, le siège national du PCF situé sur la place parisienne éponyme. A l’initiative de l’Union des Étudiants Communistes (UEC), cette rencontre entre des étudiants engagés dans des organisations syndicales différentes, notamment l’UNEF et la Fédération syndicale étudiante (FSE), m’a permis de mieux faire le lien entre le travail d’un syndicaliste sur le terrain, dans son milieu, et la nécessaire perspective révolutionnaire que propose le mouvement communiste. J’aime à penser que je fais partie des rares personnes qui, n’étant issues ni d’une famille communiste ni d’une quelconque banlieue rouge, ont activement participé à une réunion au Colonel avant même d’être adhérent à une organisation communiste.
C’est dans le train du retour à Lille que mon mentor syndicaliste, que nous appelions tous Duche et qui m’accompagnait à cette réunion, me sortit une carte de l’UEC que je me devais de remplir pour concrétiser mon adhésion au communisme. Je mentirais si je prétends que je n’ai pas hésité, en mon for intérieur, au moment d’écrire mon nom sur ce petit bout de carton, mais je l’ai fait et n’ai jamais regretté. Ce n’est pas pour autant que j’étais devenu communiste. Je ne le suis devenu qu’après avoir éprouvé mes thèses personnelles aux discussions jusqu’au bout de la nuit avec mes camarades et à la lecture des plus grands théoriciens, dont l’ancienneté apparente n’a d’égale que l’actualité bien réelle des analyses, à commencer par Karl Marx, Friedrich Engels et Lénine. En somme, c’est par philanthropie et empathie que j’étais de gauche, mais je ne suis devenu communiste qu’en aiguisant mon esprit critique par la découverte du socialisme scientifique et de son inégalable justesse.
Je ne serais jamais devenu adhérent communiste sans ma curiosité que je souhaitais nourrir quitte à faire tomber les préjugés que j’avais en tête, mon engagement syndical quotidien quinze mois durant ou sans mon expérience à la fois d’un travail aliénant et de la crise économique majeure qui ébranla le monde capitaliste à l’automne 2008. C’est ce qui a amené le fils d’employés ayant grandi dans l’espace périurbain lillois que j’étais à embrasser l’idéal et les pratiques révolutionnaires, à être convaincu que le PCF non seulement n’était pas mort, mais méritait de s’y engager.
Néanmoins, je suis une exception. Je le suis parmi les militants du PCF, qui ont pour la plupart connu une famille ou une ville communiste ; je le suis encore davantage parmi les enfants d’employés ayant grandi dans l’espace périurbain lillois. Si mon cheminement m’a permis de m’émanciper des idées reçues largement anticommunistes qui avaient baigné mon enfance et ma scolarité, c’est aussi le hasard des rencontres et l’amitié profonde pour des personnes qui ont contribué à construire ma personnalité d’adulte qui m’ont conduit à devenir communiste.
Or nous ne pouvons pas, en tant qu’héritiers et porteurs du drapeau rouge, compter que sur le hasard des rencontres ou l’expérience similaire à la nôtre pour espérer convaincre massivement les travailleuses et travailleurs, en formation, privés d’emploi, salariés, indépendants ou retraités, de devenir communistes. J’ai toujours été convaincu de l’engagement syndical, et de la conception communiste d’un syndicalisme nécessairement réformiste afin de gagner des droits pour toutes et tous sans attendre le « Grand soir », comme levier pour améliorer notre quotidien et amener des personnes vers la prise de conscience de classe et la prise de conscience que seule une Révolution intégrale menée par les masses de travailleurs permettra à l’humanité d’éviter la catastrophe ultime. J’en reste convaincu, il s’agit là de créer les conditions objectives de l’adhésion au mouvement communiste de l’immense majorité de la population qui y a tant intérêt.
Quinze ans après mon adhésion au PCF, quinze ans de cotisations, d’échanges et de pérégrinations à travers la France, quinze ans de Fêtes de l’Huma plus tard, je suis aussi convaincu qu’à notre environnement extérieur que nous ne maîtrisons pas et qui véhicule massivement des préjugés anticommunistes, se mêlent des facteurs endogènes, propres au mouvement communiste, qui freinent l’ouverture de nos organisations aux masses d’individualités qui, toutes et chacune, méritent d’y trouver leur place. Elles y ont intérêt ; si elles ne s’engagent pas, c’est en partie notre faute. Plutôt que de nous lamenter sur l’idéologie dominante, interrogeons-nous sur notre responsabilité dans ce qui pousse les organisations communistes à fonctionner presque en vase clos.
Le capital communiste compte parmi ces phénomènes qui agissent sur les non-militants et les non-adhérents comme un repoussoir. Il ne s’agit ni de renier notre passé, ni de jeter l’opprobre sur une partie des camarades. Il s’agit tout au contraire d’ouvrir enfin des perspectives d’appropriation massive de nos fondamentaux théoriques, de notre grille d’analyse tant utile pour appréhender le monde comme chaque vie, de nos pratiques d’organisation par lesquelles, à visage découvert, nous affrontons les tenants de l’ordre établi pour ériger un monde meilleur.
*
**
Introduction. La philosophie communiste
*
Pour appréhender correctement notre sujet, nous devrons passer au crible un certain nombre de phénomènes déterminants qui ont amené l’humanité là où elle se trouve aujourd’hui. Les périls de notre temps, de ceux qui préoccupent nos esprits, sont variés mais deux d’entre eux se détachent par leur dangerosité et la multiplication des signaux, tantôt forts, tantôt faibles, de leur réalité objective. Il s’agit de la tentation autoritaire des prétendues démocraties libérales, pouvant déboucher sur des régimes fascistes dévastateurs pour les femmes et les hommes appartenant aux classes dominées ; ainsi que de l’extinction de masse de l’holocène, parfois nommée anthropocène voire capitalocène, du nom donné par les scientifiques à notre ère géologique où l’activité humaine provoque, bien au-delà du seul réchauffement climatique, un anéantissement massif d’espèces biologiques, végétales et animales, jusqu’à la possible disparition de l’être humain.
Ces phénomènes, qui ont amené à l’organisation actuelle de notre civilisation, ont été amplement et précisément définis par la littérature communiste, s’inscrivant dans la lignée du socialisme scientifique. Ce foisonnement intellectuel, d’une richesse inégalée, connaît dans son partage entre toutes et tous l’obstacle d’une chape de plomb volontairement placée par la classe capitaliste, pour que les masses laborieuses ne s’emparent pas des outils théoriques et pratiques leur permettant de s’émanciper des dominations et d’œuvrer enfin à une société de coopération, d’égalité et de justice, de paix universelle et d’harmonie entre l’humain et son environnement.
Il nous faut donc, au préalable, battre en brèche plusieurs préjugés, diverses idées reçues qui agissent comme des freins à la prise de conscience des exploités et des opprimés d’appartenir, pour l’essentiel, à la même grande classe sociale, et d’avoir entre ses propres mains le potentiel révolutionnaire de diriger son destin et celui de l’humanité toute entière.
Dans la culture populaire, du moins celle dans laquelle tente de nous enfermer la classe dominante, la philosophie est davantage un art de vivre qu’un moyen de comprendre le monde. Être philosophe signifie, le plus souvent, prendre les choses du bon côté, prendre de la hauteur en faisant abstraction des préoccupations quotidiennes et matérielles. L’amour de la sagesse, son sens étymologique, renverrait la philosophie au pire à l’étude d’un objet étranger à notre vie courante, limité à des questions métaphysiques sur le sens abstrait de l’existence, au mieux à l’adoption des thèses du développement personnel qui ont particulièrement le vent en poupe. Le socialisme scientifique, entendu comme la démarche analytique et transformatrice du mouvement communiste, a dès le XIXème siècle dépassé ce préjugé selon lequel la philosophie ne serait que l’apanage de quelques savants et illuminés. Indissociable des progrès et découvertes réalisés par les chercheurs en sciences, la philosophie communiste est l’outil de compréhension du monde et de ses mécanismes, tout autant que la condition d’une appropriation de notre destin, individuel et collectif. En guise de conclusion de son essai sur Les Thèses de Feuerbach, à tout juste 27 ans, Karl Marx écrivait en 1845 que « Les philosophes n’ont fait qu’interpréter diversement le monde, ce qui importe, c’est de le transformer », caractérisant ainsi son œuvre prolifique qui mêlera à la philosophie les mathématiques, les sciences physiques, chimiques et biologiques, l’économie et les sciences sociales.
Parmi les autres opinions préconçues largement partagées en notre temps, se trouve l’incompatibilité profonde entre la théorie et la pratique. Le physicien du XXème siècle Albert Einstein avait déclaré, dans un de ses moments d’espièglerie, que « La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne… et personne ne sait pourquoi ». À nouveau, cette idée qui apparaît de bon sens, mais qui à l’épreuve de la réflexion scientifique se révèle, quand elle est érigée au rang de loi insurpassable, comme un vice de raisonnement, agit comme un repoussoir sur les classes exploitées vis-à-vis de toute théorie, de toute démarche visant à mettre les mots et les concepts sur ce qu’elles vivent au quotidien. Là encore, le socialisme scientifique présente une alternative à cette propagande dominante, puisque l’un de ses fondements réside dans l’articulation entre le réel, la pratique, et la théorie. Sans partir d’idées vagabondant dans notre esprit, mais en partant du vécu et de ce que les sciences nous apprennent de notre existence et de notre univers, la théorie, comme aboutissement des recherches et mise à l’épreuve des hypothèses, est au cœur des visées communistes. La théorie est à la fois l’expression scientifique, élaborée, transmissible de l’expérience pratique de l’être humain, et la condition à ce que le monde puisse, justement, être transformé. Dans son essai Que Faire ?, écrit en 1901 et publié en 1902, Lénine note que « Sans théorie révolutionnaire, (il n’y a) pas de mouvement révolutionnaire ». Éprouvée par les conditions réelles d’existence et l’expérimentation de son application, la théorie révolutionnaire, qui est comme toute théorie scientifique vouée à être dépassée par un niveau de connaissances ultérieur et supérieur, agit comme l’indispensable boussole aux masses exploitées pour conduire la métamorphose de la société humaine et ouvrir, pour l’humanité et son environnement, une nouvelle ère débarrassée des prédations capitalistes.
Le sens commun du matérialisme dans les années 2020 se résume à l’attrait, péjoratif, de certaines personnes pour les biens matériels, pour un confort garanti par de nombreux équipements dernier cri, en opposition à une forme de détachement spirituel de ce qui est produit et commercialisé. Il ne pouvait y avoir, dans cette redéfinition, pire coup de poignard dans le dos du socialisme scientifique. En philosophie, et particulièrement dans les thèses proposées par les communistes, le matérialisme s’oppose à l’idéalisme ; c’est la réflexion selon laquelle l’existence matérielle, physique, détermine la conscience des êtres humains. Pour la plupart des philosophes idéalistes, dont chaque génération se croit persuadée d’avoir inventé l’eau chaude, l’idée fait l’homme et notre âme peut faire abstraction de nos conditions d’existence pour épouser la grandeur mystique qui permettrait de trouver un sens à la vie. Dans la philosophie communiste, la matière et l’existence physique forment le socle absolu à toute théorie, quelle que soit son niveau d’élaboration. Cela signifie, d’une part, que nous n’aurions pas de conscience sans le fonctionnement chimique et électrique de notre cerveau, sans notre enveloppe corporelle et tous ses organes qui lui permettent de fonctionner ; d’autre part, que nous ne pouvons théoriser que ce que nous avons vécu, entendu, vu ou ressenti et que par conséquent, l’idée humaine n’est jamais le fruit d’une abstraction mais l’aboutissement d’une construction sociale et culturelle. Si les idées ont progressé, c’est parce que l’environnement de l’être humain a progressé par les efforts productifs, matériels et intellectuels, de toutes les générations qui nous ont précédés. Tout comme il ne peut y avoir de théorie sans pratique, ni de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire, sans le matérialisme historique la théorie communiste est vide de sens. Le matérialisme historique considère que la matière est apparue avant l’idée que s’en est faite l’être humain ; et comme nous savons, par les phénomènes physiques et chimiques connus grâce aux accomplissements scientifiques, que la matière est en mouvement perpétuel, oscillant et se fixant autour d’un équilibre entre plusieurs forces contraires elles-mêmes en évolution permanente, l’idée est logiquement soumise continuellement à un processus de développement, d’amélioration ou de dépréciation selon les domaines de connaissances, les époques traversées par l’humanité, les structures politiques et juridiques et les infrastructures économiques qui régissent sa vie en communauté.
L’idéologie, enfin, est vue de nos jours comme un gros mot, comme un mécanisme intellectuel qui enferme le sujet dans ses préjugés, réduisant l’individu à de simples réactions conformes à des préceptes intangibles. Il s’agit, en réalité, du système de pensée, collective ou individuelle, que tout un chacun compose avec la réalité de sa propre existence. Pour chaque personne, en fonction de ce qu’elle a vécu, expérimenté et connu dans sa vie, tel objet renvoie à tel mot ; tel mot renvoie à telle définition ; et telle définition, dans un système de pensée socialement déterminé, peut renvoyer à telle qualité, tel défaut ou tel principe qui la lie à d’autres mots définis de la même manière. L’idéologie ne se limite donc pas au simple dogme, mais se réfère à toute l’interprétation du monde et de ce qui le compose que s’est constituée un individu à travers ses expériences, ses connaissances, ses discussions par lesquelles il a éprouvé ses thèses personnelles à celles de son entourage. Avoir conscience de sa propre idéologie est une force dans un monde où notre intuition est déniée par les forces dominantes. De même, comprendre que nous partageons une idéologie commune, bien que ses nuances s’expriment différemment d’un membre à un autre de la communauté, comme un socle de réflexions, d’analyses, de valeurs et de principes propres à un collectif, s’avère déterminant dans notre émancipation. En effet, soit nous assumons partager avec d’autres êtres humains des définitions communes, des réflexes et des principes communs, à l’échelle d’un groupe social, d’une nation, d’une classe sociale ou à l’échelle universelle de l’humanité, soit nous n’en avons pas conscience mais sommes de facto soumis à l’idéologie dominante d’un groupe, d’une nation, d’une civilisation, idéologie communément admise comme étant la meilleure qui soit voire la seule valable et à laquelle, inconsciemment, nous nous référerons pour répondre à nos interrogations sur notre vie ou notre société.
L’hégémonie capitaliste, qui tire son pouvoir de sa domination sur le travail des exploités et des opprimés, et le maintient par une incessante propagande idéologique, semble inexorable à notre époque. Nous ferons donc l’examen historique, économique et social de cette domination sur les êtres humains de la classe capitaliste, qui a soumis à elle les vieilles dynasties et les six continents. Le potentiel révolutionnaire de la culture communiste se heurte à son incapacité à se partager au-delà des rangs des quelques personnes averties, déjà sympathisantes ou sensibilisées à la doctrine du socialisme scientifique. Nous verrons que, lorsqu’elle se mue en un simple héritage social et culturel, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui, l’idéologie communiste devient un objet creux, inanimé, un capital qui s’agglomère sans but précis et qui freine l’expansion des connaissances et, surtout, leur appropriation par le grand nombre. Enfin, compte tenu des derniers développements de l’humanité, de la composition économique et politique de notre civilisation au XXIème siècle, des forces en présence et des confrontations entre elles, nous tâcherons de donner des éléments de réponse à la problématique qui doit animer tout communiste : le socialisme scientifique peut-il gagner la bataille idéologique, à gauche, en France et dans le monde ? Le communisme peut-il encore vaincre le capitalisme ?
*
**
I. Qu’est-ce que le capital ?
*
La définition complète du capital est l’un des secrets les mieux gardés de l’ère capitaliste, tant elle révèle son caractère arbitraire et ses ravages sur l’être humain et son environnement naturel.
Le capital désigne sommairement l’ensemble des moyens de financement, de production et d’échange nécessaires à la création de la valeur ajoutée. Les terres, les immeubles, les machines, les outils, les brevets déposés sur les inventions et les processus de production, les logiciels informatiques jusqu’au moindre équipement mis à disposition par l’employeur pour que le travail soit fait composent les moyens de production.
Les capacités d’investissement et de placement, déterminantes pour l’économie réelle qui se trouve, depuis le tournant des années 1980 et la financiarisation sans entrave, en situation de dépendance totale de marchés financiers dérégulés, relèvent des moyens de financement.
Les moyens d’échange, enfin, qu’il s’agisse de transactions financières, de transports de marchandises, de voies de communication, profitent d’un maillage territorial et numérique pour que le commerce mondial et intérieur progresse toujours davantage. Disposer de commerces physiques, de serveurs de données sur lesquels sont installées les boutiques en ligne, d’importants moyens d’influence tels que la médiatisation et la propagande publicitaire revient à disposer de moyens d’échange.
Cette imbrication financière et économique d’un capital protéiforme serait moins problématique si le capital, justement, n’était pas la propriété d’une infime fraction de la population planétaire. C’est pourtant le cas. Si l’argent est l’expression la plus pure du capital, qui se traduit en volumes monétaires et financiers, son pouvoir dépasse largement le champ des devises pour s’articuler au sein de l’ensemble de notre société fondée depuis deux siècles sur le règne sans partage de la bourgeoisie capitaliste.
Quand François Hollande proclamait, en une même phrase, que son ennemi était la finance et qu’il n’avait pas de visage, le ver était pour ainsi dire dans le fruit. Car la classe capitaliste française a bien des visages, ceux de Bernard Arnault, de Françoise Bettencourt-Meyer, de Patrick Drahi, de Vincent Bolloré, de Gérard Mulliez, de Martin Bouygues, de Xavier Niel ou de Rodolphe Saadé.
Ce sont eux, les plus gros capitalistes, les propriétaires dont le patrimoine est tellement énorme qu’il est composé à plus de 95% de valeurs mobilières telles que les actions et les obligations, renvoyant leurs multiples et fastueuses propriétés immobilières à moins d’un vingtième de leur fortune. Ce sont eux, les véritables maîtres de la société dans laquelle nous vivons ou survivons, société dans laquelle la seule chose qui progresse aussi vite que le capital des milliardaires se trouve être la longueur des files d’attente des travailleurs pauvres devant les banques alimentaires.
Le capital confère non seulement un pouvoir sur l’argent, sur le financement de l’économie réelle, un pouvoir de vie ou de mort sur les entreprises ; il confère également un pouvoir sur le travail, tant celui des salariés que des fort mal nommés travailleurs « indépendants », car ce sont les donneurs d’ordre au sommet des chaînes hiérarchiques qui décident de ce qui est produit, de la quantité produite, des matériaux et des outils avec lesquels cela est produit, du prix de vente des biens et services produits ainsi que de ce qui mérite d’être promu, par l’arsenal publicitaire aux multiples tentacules.
Bien qu’apparemment dématérialisé, de même que de nombreux outils et services de notre temps, le capital dispose toujours d’une base matérielle. Nous l’évoquions plus haut : les terres, les immeubles, les machines, les outils, les brevets déposés sur les inventions et les processus de production, etc. Mais que sont ces richesses, si ce n’est le fruit du travail antérieur ?
Les terres sont entretenues par un travail minutieux et préparées, si besoin, à accueillir des chantiers. Les immeubles sont construits à la force des bras par des ouvriers du bâtiment selon des plans établis par des architectes et ingénieurs, qui ont chacun consacré un temps de travail déterminé à ce que soient érigés les édifices. Les bâtiments sont raccordés à l’énergie, l’électricité, le gaz et l’eau courante par des petites mains expertes en leur domaine. Les machines utilisées dans les usines ou dans les bureaux sont elles-mêmes le produit d’un travail antérieur concrétisé par les efforts intellectuels et manuels des concepteurs, des techniciens, des opérateurs et des manœuvres. Les outils ont été perfectionnés par ceux qui les manient eux-mêmes, pour en augmenter l’efficacité et diminuer l’effort physique que leur utilisation demande. Les inventions et processus de production sont tout autant le fruit des travailleuses et des travailleurs, même l’enrobage commercial et la marque apposée sur les produits finis ne sont jamais le résultat d’un quelconque effort du capital.
Si le capital est le fruit d’un travail antérieur, cela signifie-t-il que les capitalistes furent un temps des travailleurs ? Voilà le mythe desservi à une vitesse torrentielle à toute heure, d’année en année : Jeff Bezos, Bill Gates, Steve Jobs auraient commencé leur entreprise dans le garage de leurs propres parents. En réalité, ils n’auraient jamais bâti un tel empire commercial s’ils n’avaient pas eu un capital de départ, c’est-à-dire un héritage qu’ils ont utilisé comme moyens de financement, de production et d’échange pour lancer leur affaire. Elon Musk serait-il devenu aussi influent sans les richesses extraites des mines sud-africaines appartenant à ses parents ? Permettez-nous d’en douter.
De départ ou d’arrivée, le capital puise toujours dans sa forme matérielle, dans sa réalité physique, les ressources produites par le travail d’exploités d’hier. La propriété du capital est la confiscation du travail antérieur, comme s’il revenait de droit aux capitalistes, tout comme il confère un pouvoir maximum sur le travail actuel, sur les efforts produits par les exploités d’aujourd’hui. Bien que fructifiée à des niveaux inégalés dans l’histoire humaine par le biais des échanges illimités et ultra-rapides sur les marchés financiers, la fortune capitaliste ne serait rien sans sa base physique. Cette base physique, c’est la spoliation légale, l’extorsion institutionnalisée, que constitue la récolte de toute la valeur produite hier et aujourd’hui par les travailleuses et les travailleurs eux-mêmes.
Fondé sur le dépouillement de ce qui aurait dû revenir aux authentiques producteurs de richesses, le capital est également le carburant de l’exploitation de nos jours, sous le prétexte qu’il est légitime que les propriétaires des moyens de production décident de ce que font les employés sur leur temps de travail ; exploitation qui n’a d’autre but que d’alimenter, encore et toujours, jusqu’à l’écœurement, le capital qui grossit de jour en jour, d’année en année et de siècle en siècle. Ainsi s’étend la propriété lucrative.
Sans surprise, le capital s’avère central dans la définition des rapports sociaux sous le règne du capitalisme. Quelques-uns disposent d’un capital, qu’ils ont au moins en partie hérité ; cela leur permet d’investir dans des activités qui doivent être rentables, au sens d’alimenter une rente, et d’acheter la force de travail d’autrui pour faire fructifier ce capital et voir exécutés les ordres qu’ils clament. L’immense majorité est dépourvue de capital, elle n’a d’autre choix que de compter sur ses efforts physiques et intellectuels pour subsister, ce qui revient généralement à vendre sa force de travail, vendre des heures de sa vie, vendre une part conséquente de son existence éveillée, à un employeur qui décidera quels gestes elle devra répéter et quel salaire elle obtiendra en contrepartie. Un salaire largement insuffisant pour se constituer un capital, à peine suffisant pour manger à sa faim tout le mois, tout juste suffisant pour obliger à retourner au travail jour après jour parce qu’aucune autre perspective ne s’offre aux démunis.