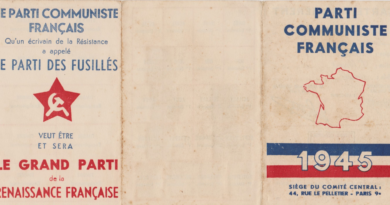Le Capital communiste 3/10 – Prix et opposition de classes
Le Capital communiste est une brochure écrite en juin 2023 par Benoit Delrue, journaliste et directeur de publication d’Infoscope.
Un an plus tard, à l’heure où le pays plonge dans la mécanique nationaliste, nous interrogeons les faillites de la gauche de transformation sociale, politique et révolutionnaire. Ce présent ouvrage, publié sur notre site en une série d’articles, y contribue.
Cette deuxième des dix parties du document, que nous publions en exclusivité et en accès libre, en intégralité du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2024, comporte le Chapitre 5 : Prix et opposition de classes, le Chapitre 6 : Première et Deuxième Révolutions industrielles et le Chapitre 7 : Le marché du travail.
Retrouvez la table des matières
*
**
V. Prix et opposition de classes
*
Pour finir sur la question plus générale de la marchandise, le prix d’un produit ne correspond pas nécessairement, uniquement, à sa valeur d’échange. La fameuse « loi de l’offre et de la demande » permet à la bourgeoisie capitaliste devenue classe dominante de pratiquer, en période de forte demande boostée (favorisée grandement) par la suggestion publicitaire, par le crédit à la consommation malgré un contexte de bas revenus, une forte élasticité des prix, qui peuvent flamber par le seul jeu des marchés financiers, sur lesquels s’échangent les stocks de marchandises mondiales. L’or et l’énergie fossile sont, particulièrement lors des crises économiques qui reviennent cycliquement dans le système capitaliste pour mieux solder ses surplus et régénérer sa capacité à exploiter et conquérir des marchés, des valeurs-refuge par excellence.
Il n’est, dès lors, pas étonnant que le pétrole et le gaz, avec l’invasion russe en Ukraine début 2022, ont été achetés en masse, en millions de barils et de tonnes, par les investisseurs capitalistes sur le marché international. Ce phénomène a engendré une forte augmentation des prix de ces produits énergétiques, provoquant de fait une hausse considérable de l’ensemble des produits alimentaires ou manufacturés convoyés aux quatre coins du globe par navires porte-conteneur gourmands en énergie fossile, ainsi qu’une très lourde augmentation du prix de l’électricité, que les décideurs du marché européen ont eu la brillante idée d’aligner sur celui du gaz.
L’électricité a donc vu son prix croître sensiblement alors que la quantité de travail socialement nécessaire, en fonction de la qualité de la force de travail et du niveau de développement des forces productives, pour produire et acheminer un kilowatt-heure électrique n’a absolument pas augmenté aussi fort. Le marché capitaliste, fondé sur la concurrence, la compétition, le secret des affaires et l’accumulation massive, s’il a permis une libération du progrès technique et scientifique lorsqu’il s’est imposé au féodalisme, agit désormais comme un facteur d’inertie pesante, un frein puissant au développement des forces productives que permettrait la libre coopération entre travailleurs de toutes nations, une force conservatrice qui tente au maximum de faire barrage à un progrès technique, économique qui lui échapperait et par voie de conséquence au progrès social.
Face à la domination capitaliste, dont nous avons déterminé qu’elle était fondée sur l’accaparement spoliatif des forces productives amassées sous forme de capitaux, qu’elle s’étendait par l’exploitation de la force laborieuse achetée sur le marché du travail et qu’elle se maintenait par une incessante propagande jusque dans les têtes des exploités et des opprimés, la classe ouvrière ne dispose pas des mêmes armes. Quand la classe bourgeoise détient une force de frappe financière, économique, militaire, stratégique, idéologique dont la démesure ravage la Terre, ainsi que de relais politiciens et médiatiques pour faire valoir ses intérêts, le prolétariat de notre temps ne peut, quant à lui, compter que sur ses petits gestes, ses petites expressions de la solidarité de classe, ses petites actions du quotidien pour, à défaut de récupérer les masses de richesses confisquées par le capital, tenter de partager ses maigres revenus du travail au sein de sa famille, de sa communauté, de son association, de son syndicat ou son parti.
Pourtant, la classe ouvrière détient deux armes que n’aura jamais la bourgeoisie capitaliste : le nombre, car elle est de très loin majoritaire dans la population française, européenne et mondiale ; et sa qualité de productrice de richesses. Si la dénomination de classe ouvrière est utilisée ici, c’est parce qu’elle correspond parfaitement à cette classe sociale majoritaire qui œuvre à la richesse des nations et de notre société mais qui se trouve dépourvue de tout capital, de toutes capacités d’investir et de surcroît d’acheter la force de travail d’autrui, qui a peut-être un téléviseur écran plat et un smartphone mais qui reste démunie de toute citoyenneté économique, au sens d’avoir voix au chapitre sur ce qu’elle produit ou sur le but de son travail social. Elle est même le plus souvent démunie de sa citoyenneté politique, l’engagement civique se heurtant au règne de l’argent-roi et de la propagande bourgeoise tantôt néolibérale, tantôt nationaliste diffusée sur les antennes et les réseaux sociaux à heures de grande fréquentation, faisant des scrutins électoraux dans les prétendues « démocraties libérales » de piètres spectacles sous le poids du diktat, bien réel, du capital.
Il semble nécessaire de rappeler que la société française de nos jours est riche de sa diversité de conditions sociales bien que la plupart d’entre elles se trouvent assujetties au pouvoir capitaliste. Les communistes ne réfléchissent ni de manière binaire, ni selon des préceptes manichéens ; il ne s’agit pas, pour eux, de porter un jugement de valeur subjectif sur les faits et gestes de celles et ceux qui nous gouvernent, mais de décortiquer une réalité complexe et de combattre les phénomènes d’exploitation, d’extorsion, d’aliénation, d’exclusion et de division populaire. De même, il n’existe pas en France que deux classes sociales que seraient d’un côté les milliardaires et de l’autre des misérables sans le sou. L’existant est plus nuancé : la bourgeoisie, qui se distingue par la propriété lucrative de moyens de production, de financement et d’échange, est composée d’une multitude de strates allant du petit entrepreneur qui « mouille la chemise » aux côtés de ses salariés, dans la restauration par exemple, jusqu’à MM. Arnault et Bolloré à la tête d’empires gigantesques. De même, la classe ouvrière, si nous considérons qu’elle désigne généralement les employés de l’agriculture, de l’industrie et des services, connaît des situations financières variées, une part non négligeable de ses membres parvenant à épargner ou à devenir propriétaires de leurs logements – après des décennies de remboursement de l’emprunt immobilier auprès de la banque – quand d’autres, privés d’emploi et de tous droits, n’ont pas un toit sur la tête et vivent à la rue.
Servant de soupape permanente entre les donneurs d’ordres capitalistes et la classe ouvrière assignée à ses postes de travail, une chaîne de commandement très hiérarchisée encadre les administrations, les entreprises publiques et privées depuis le petit manager de la restauration rapide ou chef d’équipe à l’usine jusqu’aux hauts cadres dirigeants qui émargent à des salaires annuels à six chiffres. Plus ou moins proche de la classe ouvrière, cet encadrement, cette classe intermédiaire que les premiers théoriciens socialistes et communistes qualifiaient au XIXème siècle de classe moyenne, veille au grain sur la production de la valeur ajoutée au sein des espaces de travail pour le compte exclusif de sa direction capitaliste – c’est son rôle. En fonction de son entourage familial ainsi que de sa situation économique et sociale, elle peut, comme la petite bourgeoisie, devenir un temps donné l’alliée de la classe ouvrière lorsque le grand capital va trop loin dans l’exploitation et le dépouillement des travailleurs. C’est pourquoi il n’est pas rare, lors d’un conflit social majeur dans une entreprise donnée, sur un piquet de grève tenu par des opérateurs et des manœuvres, de voir les ingénieurs, techniciens et cadres glisser discrètement un billet dans la caisse de solidarité des grévistes avant de se rendre au travail pour encadrer une usine vide.
Si nous nous concentrons à ce point sur la classe ouvrière, c’est parce qu’elle est la classe révolutionnaire par excellence. Faire progresser sa conscience de classe, c’est-à-dire sa conviction forte d’appartenir à un même groupe social défini par ses rapports de production, c’est faire progresser la conscience révolutionnaire. Lorsque la classe ouvrière développe ses propres forces en s’organisant par elle-même, pour elle-même, y compris sur des sujets apparemment anecdotiques ou d’importance mineure comme l’obtention de tickets-restaurant, elle permet à la société toute entière de faire un (petit) pas vers la Révolution. Il s’agit, pour elle, de canaliser son énergie militante vers l’établissement des conditions physiques, matérielles et idéologiques de sa prise de pouvoir sur la bourgeoisie capitaliste, pour reprendre tout ce que cette dernière lui a dérobé et devenir enfin l’actrice majeure et décideuse de notre économie, tout autant qu’au sein d’institutions politiques authentiquement démocratiques.
Cette notion de démocratie populaire est centrale dans l’idéologie communiste. Sous la plume de Karl Marx, de Lénine ou des théoriciens plus proches de nous s’inscrivant dans la lignée du socialisme scientifique, l’idéal de société est généralement appelé communisme, le nom donné à une société sans lutte des classes, car sans classes sociales opposées, car uniquement constituée de producteurs de richesses ; ce qui nous importe davantage est le processus permettant de passer de la situation actuelle à cet idéal, autrement dit une phase de transition qui portera différents noms selon les auteurs et les époques.
L’État, depuis les premières civilisations humaines, a toujours été l’expression de la domination d’une classe sociale sur les autres. L’État féodal consacrait la domination de la noblesse aristocratique et du haut-clergé sur les autres classes sociales, notamment le Tiers-Etat constitué de la bourgeoisie et de la classe des serfs. L’État capitaliste consacre la domination de la bourgeoisie. Contrairement aux anarchistes, qui considèrent qu’une Révolution prolétarienne peut mener rapidement à l’extinction de l’État, les communistes considèrent que les forces de la bourgeoisie ne pourront être défaites qu’à condition que la classe ouvrière s’érige elle-même en classe dominante. C’est ce que les révolutionnaires nommeront la dictature du prolétariat, ou le socialisme, comme l’organisation provisoire de la société à l’échelle nationale et internationale pour anéantir les pouvoirs de nuisance et les capacités de réaction d’une classe capitaliste dont les moyens financiers, militaires, policiers, impérialistes ne pourront être vaincus qu’à l’échelle de la planète, par un prolétariat particulièrement uni dans le combat pour son émancipation propre, ce qui aboutira à une paix définitive pour notre espèce et à l’extinction logique de l’État en tant qu’incarnation d’une domination de classe.
*
**
VI. Première et Deuxième Révolutions industrielles
*
Quand la bourgeoisie capitaliste, en pointe de la Révolution de 1789, a abattu le féodalisme et libéré des millions de prolétaires du servage, elle s’est retrouvée en situation de force pour créer les conditions, qui lui sont le plus favorables, d’un système économique au service de sa propre accumulation.
Nous avons vu qu’il ne peut y avoir de création de valeur sans travail, sans transformation productive. Or la création de valeur est au cœur du système capitaliste. Elle est mesurée par le calcul du Produit intérieur brut (PIB), c’est-à-dire la somme de toutes les valeurs ajoutées produites dans une période donnée, le plus souvent un trimestre ou une année, et dans un territoire donné, en l’occurrence à l’intérieur des frontières nationales. La croissance du PIB, c’est-à-dire l’augmentation d’une année sur l’autre de la somme des valeurs ajoutées produites à l’échelle nationale, est la condition impérative au développement du capital.
Pour faciliter la mise en adéquation de ses besoins en force de travail avec ses exigences de croissance, la classe capitaliste a étendu dans tous les secteurs de l’économie, dans tout le pays et bientôt dans le monde, le marché du travail. Le bénéfice de ce système est double : d’une part il lui permet d’acheter la force, le temps de travail pour répondre précisément à ses objectifs de production, d’autre part il entretient le mythe d’une liberté totale, pour le travailleur, de « choisir » ce qu’il va produire, à quelles conditions, en somme de déterminer lui-même à qui et pourquoi il vendra sa force de travail.
Les cohortes de travailleurs émancipés de leur condition antérieure de serfs se sont mises à chercher du travail. La bourgeoisie, qui est surtout établie dans les villes où elle profite de la concentration des forces productives dans des ateliers artisanaux, puis des fabriques mécanisées, enfin des usines, a alors poussé les exploités à quitter la campagne pour gagner les espaces urbains. L’exode rural s’est conjugué à l’expansion considérable de ces derniers tout au long des XIXème et XXème siècles.
En prenant le pouvoir sur l’organisation de l’ensemble de la production intérieure, la nouvelle classe dominante a logiquement redéfini la division sociale du travail à l’échelle de la société. Profitant de son attachement aux sciences, dont les recherches n’étaient plus assujetties à l’inertie obscurantiste de l’Ancien régime, et poursuivant son but d’accroître la masse de richesses produites à tout prix, elle a concentré ses efforts sur une recomposition productive autour des travaux à forte valeur ajoutée, notamment dans le secteur industriel au détriment de l’agriculture.
Le développement de l’industrie finirait, de toute manière, par transformer le travail dans l’ensemble des secteurs de l’économie. Déjà la Première Révolution industrielle avait eu lieu, au XVIIIème siècle, avec l’apparition de la machine à vapeur et les prémices d’une division plus fine du travail : l’on passait de l’artisanat, où un travailleur réalisait de bout en bout un produit, à des fabriques où le même produit passait d’un poste de travail à un autre où les employés ajoutaient, sur chaque poste, une part de la valeur ajoutée, pour un produit final à la valeur plus élevée sans que la quantité de travail, en temps socialement nécessaire à son élaboration, ne s’en trouve augmentée.
Le marché du travail était initialement peu régulé et la plupart des exploités étaient embauchés à la journée. Ces journaliers se levaient tôt le matin, se présentaient aux portes des fabriques et étaient, selon les besoins de la direction, employés ou non pour répondre aux objectifs productifs. Alors que toutes les sphères de l’économie, du logement au travail lui-même en passant par la nourriture, qui n’était logiquement plus retenue sur la récolte par des exploités qui avaient quitté le domaine agricole, se transformaient en marchandises qu’il convenait de payer, les besoins en argent de l’ensemble de la population, et particulièrement de ses strates les plus populaires, se faisaient plus forts.
Heureusement, l’impératif de croissance permettait de trouver un nouvel équilibre, quoi qu’en perpétuelle évolution : les travailleurs n’étaient pas embauchés tous les jours, mais ils étaient payés suffisamment dans la semaine pour subvenir à leurs besoins les plus stricts, et revenir la semaine suivante vendre à nouveau leur force de travail. Cette dernière était habilement employée par la classe capitaliste pour accroître la valeur ajoutée et développer les forces productives comme jamais. Plus les moyens de production se déployaient et se perfectionnaient, plus la division du travail se fractionnait en une multitude de postes où les ouvriers spécialisés amélioraient leur technique, et plus les besoins en force de travail se faisaient importants.
La Deuxième Révolution industrielle va généraliser les gigantesques lieux de production où ce ne sont plus quelques pièces qui sortent de l’atelier ou de la fabrique chaque jour, mais des milliers. L’usine est le lieu où se retrouvent des centaines d’ouvriers, répartis selon une organisation scientifique du travail – popularisée par l’ingénieur étasunien Frederick Winslow Taylor dans les années 1880 – où, sur chaque poste, ce ne sont plus que deux ou trois gestes que chaque employé reproduit à l’infini pour gagner en productivité à des niveaux phénoménaux. Le produit, sur une longue chaîne de production, passe d’un poste de travail à l’autre, d’une main d’ouvrier à une autre, pour être finalisé en un temps record. Une part des machines ainsi produites va venir, justement, améliorer encore la productivité en remplaçant certains gestes effectués autrefois à la main, et reproduits cette fois mécaniquement à une vitesse inégalée.
Le déploiement de l’électricité et l’invention du moteur à explosion, ou moteur thermique, marquent également la Deuxième Révolution industrielle. Leur usage croissant va transformer la production tout autant que la vie de la population, d’abord bourgeoise, puis prolétaire, en s’introduisant dans les habitations et en s’imposant dans les rues des villes. Le télégraphe, la voiture, le téléphone, la radio, le tracteur, le réfrigérateur, la télévision apparaissent coup sur coup en parallèle des mitrailleuses Gatling, des avions, des chars d’assaut, des sous-marins dans un domaine militaire où la puissance de feu croît terriblement.
*
**
VII. Le marché du travail
*
Dans ce monde nouveau qu’est le capitalisme, le travailleur dispose apparemment du droit de vendre sa force et son temps au plus offrant, au patron qui lui permettra de faire une activité qu’il juge utile et dont il retirera un juste salaire.
Mais le rapport entre un employeur et un employé, matérialisé dans la loi et dans le droit par un contrat de travail, ne se fait pas entre deux parties égales. Si le capitaliste refuse de signer le contrat de travail, il sait que d’autres candidats se présenteront à sa porte pour proposer leurs services, et si ce n’est pas le cas, il perdra tout au plus le bénéfice d’une journée de production. Si le prolétaire ne signe pas le contrat de travail, il risque de ne pas pouvoir se nourrir, ni nourrir sa famille. L’un joue l’accroissement de son capital sur une période courte, voire négligeable ; l’autre joue sa survie.
Le travailleur se trouve donc, le plus souvent, contraint d’accepter l’emploi qu’on lui propose, et ce, même s’il s’agit d’une tâche pénible et mal rémunérée. Par le contrat de travail, que l’employeur ou son représentant rédige en des termes, certes établis par la loi, mais souvent difficiles à comprendre et aux subtilités nombreuses pour le salarié, c’est un lien de subordination, nomination consacrée par le droit français, qui lie le patron à l’employé. Autrement dit, le salarié est contraint d’exécuter tous les ordres du cadre ou de l’employeur qui se trouve en situation de domination hiérarchique – et en cas de refus d’application par l’employé de ce qui est attendu de lui par la bourgeoisie, le contrat de travail est rompu et la paye, perdue.
La classe capitaliste a intérêt à augmenter toujours davantage la somme de la valeur ajoutée au sein de ses entreprises, donc à employer massivement la force de travail de la classe ouvrière ; mais elle a aussi intérêt à ce que cette dernière soit faible, et elle ne l’est jamais autant que sous la menace du chômage. C’est pourquoi, profitant de crises dues à l’explosion de bulles spéculatives sur les marchés financiers ou à l’impossibilité d’écouler des stocks par manque de demande sur les produits existants, la bourgeoisie maintient une partie du prolétariat en situation d’exclusion de l’emploi. Le bénéfice d’une telle exclusion est triple : s’il y a plus d’offre de force de travail que de demande de celle-ci, c’est-à-dire s’il y a moins d’offre d’emploi que de demandeurs d’emploi, alors le patronat pourra imposer aux travailleurs sous ses ordres des salaires réduits, par la simple loi de l’offre et de la demande, qu’ils seront forcés d’accepter sous peine de se retrouver le ventre vide. De plus, la condition de ces bataillons de travailleurs privés d’emploi, cette « armée de réserve » théorisée par Karl Marx, agit comme une menace permanente sur les travailleurs embauchés ; à tout instant, l’employeur pourra menacer un salarié de le virer s’il n’accepte pas les tâches pénibles au bon vouloir de sa hiérarchie, ce qui presse les employés de travailler plus intensivement, d’être plus productifs quitte à s’épuiser, et de faire bonne figure devant le patron en montrant leur attachement à l’entreprise et à ses objectifs de croissance.
Enfin, laisser des milliers voire des millions de travailleurs en situation d’exclusion de l’emploi légal permet de les mettre en situation de dépendance de l’emploi illégal. Le chômage de masse est la première condition au développement du travail au noir, autrement dit non déclaré et sans contrat de travail, donc sans aucune protection en cas d’accident du travail, sans cotisation pour les périodes d’inactivité ou pour la retraite, sans la reconnaissance sociale que peut conférer un emploi légal – par exemple, pour garantir le paiement des traites au moment de contracter un emprunt bancaire.
Si les trafics et le crime organisé prospèrent, c’est d’abord et avant tout en raison de la situation d’exclusion sociale de pans entiers de la société, parfois massés dans les mêmes quartiers populaires, abandonnés par l’État, ses administrations et ses services publics, refusés d’être inclus dans l’emploi légal par la bourgeoisie capitaliste. Cette dernière ne fait, d’ailleurs, que reproduire dans les marchés illégaux ce qu’elle a mis en place dans les secteurs licites de l’économie, sous une forme plus brute, plus sauvage : l’emploi de petites mains qui font tourner les trafics, une chaîne de commandement hiérarchique particulièrement bien articulée pour agir comme une soupape, faire accepter les ordres venus du haut aux employés du crime et procéder si besoin à des règlements de compte, et au sommet les criminels en col blanc qui apportent à l’affaire les financements nécessaires pour la faire tourner et qui en retirent un maximum de bénéfices, de plus-value.
Ces financeurs et bénéficiaires ne sont autres que la bourgeoisie capitaliste elle-même, seule à même d’apporter les moyens de financement, de production et d’échange demandés par l’organisation d’un tel trafic, qu’il s’agisse du marché des drogues, des armes, des organes ou du sexe tarifé qui place en situation d’esclavage des femmes, parfois des filles à peine sorties de l’enfance. Partout où le capital étend ses tentacules et impose son diktat, partout la mafia se développe en calquant de manière plus féroce l’exploitation du travail des petites mains, depuis la production jusqu’à la vente finale au consommateur, que nous retrouvons dans le marché du travail légal.
Le capitalisme triomphe par la marchandisation, la commercialisation de toutes ressources, de tous produits, y compris la force de travail elle-même. Si le prix auquel la force de travail est achetée par la bourgeoisie connaît une certaine élasticité par le jeu de l’offre et de la demande, la valeur de la force de travail est déterminée, sous le capitalisme, autour de la satisfaction des besoins sociaux rudimentaires pour une période donnée. Autrement dit, le travail est généralement rémunéré par la somme précisément nécessaire à la reproduction de la force de travail. Chaque jour, chaque semaine ou aujourd’hui, le plus souvent dans le marché légal, chaque mois, la paye du travail correspond à la somme monétaire indispensable à la solvabilité, relative, de l’employé sur le marché des biens et services, donc au recouvrement de la force de travail. Chaque paye permet, peu ou prou, au travailleur de récupérer son énergie en s’alimentant, en se logeant, en se divertissant pour se vider la tête de l’aliénation du travail et s’avère juste suffisante pour que l’employé retourne au turbin jour après jour.
*
Retrouvez la table des matières