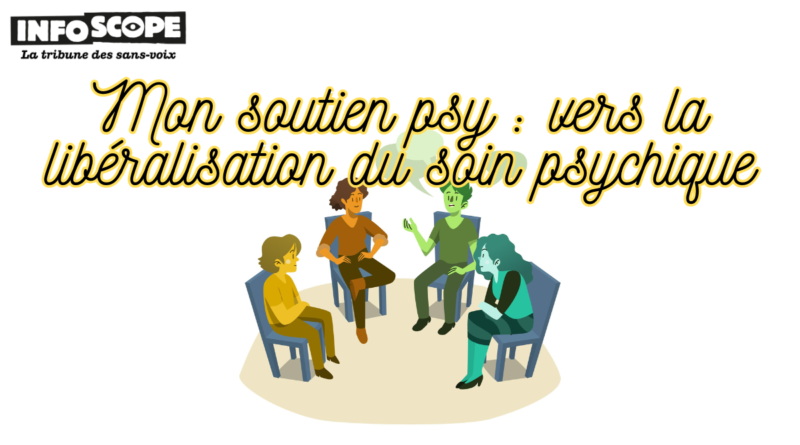Mon soutien psy: vers la libéralisation du soin psychique
Si nous sommes habitué-e-s à ce que les grandes causes ne représentent rien qu’un affichage politique (pour rappel, la lutte contre les violences faites aux femmes a été deux fois grande cause nationale sous Macron), cette année 2025, c’est la santé mentale qui a été choisie comme décoration par Michel Barnier.
La santé mentale, supposée grande cause nationale 2025, repose sur quatre objectifs majeurs :
• La lutte contre la stigmatisation,
• Le développement de la prévention et du repérage précoce,
• L’amélioration de l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire,
• L’accompagnement des personnes concernées.
Cette décision fait sans doute suite à une proposition de résolution portée par Madame Nathalie Delattre, à l’époque sénatrice et actuelle ministre déléguée chargée du tourisme, adoptée au Sénat le 17 janvier 2024.
« Soutien psy » : un dispositif évolutif qui « ne fonctionne pas »
Un sujet politiquement peu présent mais une cause importante, puisque la prévalence des problèmes de santé mentale en France est la plus importante en Europe. Si les Français-e-s se sentent de plus en plus concerné-e-s par cette problématique, leur perception évolue également. Selon une enquête IPSOS, 55 % d’entre eux déclaraient en 2024 porter une attention particulière à leur santé mentale, contre 41 % en 2021. Pourtant, la dépression touche encore un-e Français-e sur quatre et 31 % de la jeune génération (-30 ans).
Face à cette réalité alarmante, notamment chez les jeunes, l’accès à des soins psychologiques adaptés devient un enjeu crucial.
Le dispositif « Soutien psy », lancé en avril 2022, permet le remboursement de douze séances chez un psychologue partenaire du programme. Il s’adresse à toute personne à partir de trois ans ressentant une « souffrance psychique légère à modérée ». Chaque séance est remboursée à hauteur de 50 euros.
En 2024, 3 550 psychologues étaient conventionnés pour 84 007 praticiens en France, et 381 000 patient-e-s ont bénéficié du dispositif (70 % des femmes).
Si l’idée du remboursement des consultations chez un psychologue est défendue depuis de nombreuses années, la mise en place de ce dispositif a suscité de vives critiques. Quand il était Premier ministre, Gabriel Attal a lui-même reconnu : « ça n’a pas fonctionné ». En 2024, le dispositif a été doté d’un budget de 170 millions d’euros.
Ce programme a connu plusieurs évolutions. D’abord, il a changé trois fois de nom. Ensuite, à son lancement, seules huit séances étaient remboursées, et le-la patient-e devait impérativement être orienté-e par un médecin. Cette obligation a provoqué la colère des psychologues, qui dénoncent une médicalisation de leur profession, alors qu’ils ne sont pas médecins, contrairement aux psychiatres. Enfin, le montant du remboursement a été revalorisé, passant de 30 à 50 euros par séance.
Un outil imposé aux professionnel-les
Conçu sans concertation avec les professionnel-les du secteur, ce dispositif a suscité une forte opposition de la part des psychologues, donnant lieu à plusieurs appels au boycott, notamment par le collectif « ManifestePsy ».
En 2023, ce dernier a publié un manifeste visant à « construire aujourd’hui le futur des psychologues cliniciens et psychothérapeutes en France », proposant 18 mesures sur la formation, le statut des professionnel-les et la prise en charge des soins.
Avant même de débattre du fond de la mesure, les psychologues dénoncent l’investissement financier accordé au dispositif alors que les Centres Médico-Psychologiques (CMP), censés assurer un accueil, un suivi et une orientation des patient-e-s, sont en grande difficulté financière. Ces structures, qui permettent un accès direct à un psychologue sans prescription médicale et une prise en charge sans limitation de durée ni restriction de temps de séance, souffrent de délais d’attente allant de plusieurs mois à un an, souvent plus.
Financièrement, avec une taxation de 50 à 60 %, les psychologues perçoivent en réalité entre 20 et 25 euros par séance, une rémunération bien inférieure à leurs tarifs habituels. Le paiement par la CPAM peut prendre plusieurs mois, créant un décalage dans leur comptabilité. Avec un budget de 170 millions d’euros, on estime que 2 500 postes auraient pu être financés en CMP.
Finalement, le dispositif « Soutien psy » soutient une tendance de libéralisation de la profession tout en participant à la destruction du service public de la santé mentale. (L’abandon des hôpitaux psychiatriques étant tout aussi problématique que celui des CMP.)
Au-delà de la précarisation de la profession, ce sont les patient-e-s qui se retrouvent en danger
• Premièrement, le dispositif repose sur des critères d’exclusion selon le niveau de souffrance mentale. Certains sites publics établissent même une liste de troubles mentaux éligibles, pathologisant ainsi les patient-e-s qui ne correspondent pas aux critères dépressifs requis pour être pris-e-s en charge.
• Deuxièmement, bien que le nombre de séances remboursées ait été augmenté, 12 séances restent une prise en charge très courte pour un suivi psychothérapeutique global.
• Troisièmement, il est impossible de déterminer à l’avance si un-e patient-e souffre d’un trouble « léger à modéré », et un-e patient-e nécessite parfois une équipe et non pas seulement un psychologue : orthophoniste, psychomotricien, etc.
Aucun de ces critères ne permet de déstigmatiser les troubles mentaux, ni de travailler au repérage précoce de problématiques.
Pour une approche politique et sociale de la santé mentale
À l’Assemblée nationale, les groupes LFI (via Élise Leboucher) et EELV (via Sébastien Peytavie) ont déposé un amendement, adopté dans le cadre du projet de loi de finances 2025, demandant un rapport d’évaluation du dispositif dans un délai de six mois.
Pour conclure, si la santé mentale est enfin désignée comme grande cause nationale en 2025, il est urgent que cette annonce dépasse l’affichage politique. La santé mentale est une problématique collective, touchant de manière inégale les différentes catégories de la population. Elle ne doit pas être un sujet de privilégiés alors que le sujet demeure délaissé par les classes populaires, les hommes et les personnes racisées (personnes dites non blanches à qui l’on donne une race au sens sociologique).
Les critiques autour du dispositif « Soutien psy » soulignent non seulement la précarisation des professionnel-les de la psychologie, mais aussi l’inadaptation d’une prise en charge limitée. Une politique de gauche devrait reposer sur une concertation étroite avec les professionnel-les du secteur et un renforcement massif des structures publiques comme les CMP.
L’enjeu dépasse la question économique : il s’agit de reconnaître la santé mentale comme un droit fondamental, universel et accessible. Faute de cela, cette grande cause nationale restera un nouvel échec des années Macron.